Le RSA, la petite aide qui monte en agriculture
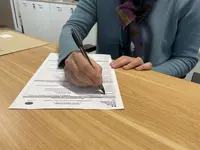
Pendant que les effectifs d’exploitants et le budget de la Pac s’érodent, le nombre d’agriculteurs bénéficiaires du RSA progresse, de 25 % depuis dix ans. Une tendance qui semble tenir autant de la banalisation du dispositif que de la précarisation d’une partie du secteur agricole. Bien qu’il reste marginal, bénéficiant à 2,5 % des exploitants en 2023, soit un agriculteur sur quarante, le RSA ne semble plus être un tabou parmi les jeunes générations, qui l’utilisent aussi bien comme une aide sociale qu’un « tremplin » pour l’installation, notamment en maraîchage bio. Malgré cette dynamique, le taux de non-recours reste élevé en agriculture, à près de 40 %, soit 6 points de plus que la population générale. Pour y remédier, l’automatisation des procédures est en route. Mais la réforme du RSA pourrait enrayer ces efforts, obligeant les bénéficiaires à effectuer 15 heures d’activités en 2025. Des assouplissements sont toutefois dans les tuyaux, à défaut d’une dérogation.
Année de toutes les crises (MHE, FCO, moissons, vin rouge, bio, signes de qualité…), 2024 ne risque pas de changer cette tendance : le nombre d’agriculteurs bénéficiaires du RSA socle a progressé de 25 % depuis dix ans. Entre banalisation du dispositif, notamment chez les jeunes, et précarité d’une partie des agriculteurs, la tendance reste difficile à analyser, mais traduit de fait une montée en puissance de ce dispositif, longtemps tabou dans le secteur agricole. Comme l’eau et l’huile, les clichés de l’exploitant et du RMiste ont longtemps semblé s’opposer.
À première vue, le RSA reste effectivement marginal à l’échelle de la Ferme France. Ce sont seulement 2,5 % des exploitants qui en bénéficient du socle en 2023, soit un agriculteur sur quarante. Mais même si ce taux reste encore inférieur à celui que l’on retrouve dans la population générale, le chiffre est d’un ordre de grandeur similaire : 4 % des Français de 15-69 ans sont allocataires du RSA socle. Et les courbes pourraient bien se croiser à l’avenir, puisque le RSA stagne en population générale depuis dix ans, tandis qu’il progresse dans le secteur agricole.
Pour comprendre cette évolution, les chiffres restent rares. Les conseils départementaux, co-financeurs du RSA et responsables de l’accompagnement social, nous ont esquissé, à l’oral, une « carte de France » du RSA en agriculture. Premier constat, le maraîchage est souvent cité, en particulier pour les phases d’installation. « C’est notamment le cas dans la Drôme, les Bouches-du-Rhône et la Vendée, égrène l’association Départements de France à Agra. Les jeunes maraîchers en dépendent en effet souvent, surtout dans les premières années d’installation ».
L’élevage et la bio reviennent aussi régulièrement, en raison de la fluctuation des revenus. L’Ariège ou le Lot-et-Garonne, où l’agriculture bio et la polyculture sont très présentes, montrent aussi une dépendance au RSA, expliquent les collectivités : « Des filières comme l’élevage, la viticulture et les petites exploitations spécialisées sont également concernées dans des départements comme la Lozère, le Cantal et la Corrèze. »
Mais le RSA ne se limite pas aux régions de faibles revenus agricoles : « Dans des régions viticoles prospères comme l’Hérault ou la Gironde, de jeunes viticulteurs dépendent du RSA en raison de la précarité économique. Même en Île-de-France, notamment en Seine-et-Marne, de jeunes exploitants, surtout dans le maraîchage, recourent au RSA pour compenser des revenus insuffisants », précise l’association.
Le RSA, pas un tabou pour les jeunes
L’un des moteurs de l’essor du RSA en agriculture, c’est la disparition progressive du tabou qu’il représente dans le secteur. C’est l’un des constats dressés en 2021 par le chercheur François-Xavier Merrien, pour l’association Gers solidaire. « Avec le temps, l’attitude traditionnelle, mélange de honte et de méfiance, tend à disparaître notamment lorsque les circonstances particulières l’exigent, explique-t-il. Les nouvelles attitudes sont partagées entre la revendication coléreuse chez les plus âgées et la demande légitime chez les plus jeunes ».
Chez ces derniers, souvent de très petites exploitations, souvent en bio, le RSA est considéré comme une aide légitime, même s’ils aimeraient s’en passer. « Les nouveaux installés ont une vision différente de l’agriculture, reconnaît Marie-Andrée Besson, présidente de l’association Solidarité Paysans. Ils conçoivent le RSA comme un tremplin pour le début de leur activité, car tout le monde ne démarre pas en agriculture avec un capital important. »
Pour François Xavier Merrien, la montée en puissance de cette aide marque plus généralement une banalisation des aides de crise en agriculture. « Le système agricole a intégré l’existence d’aides particulières en cas de difficultés et peu à peu celles-ci sont moins perçues comme une aide sociale stigmatisante, synonyme de défaillance individuelle et plus comme une aide à l’exploitation. »
Un fort taux de non-recours
Mais demander à bénéficier du RSA reste une démarche difficile pour les exploitants, où la figure du RMiste fait souvent figure de repoussoir. Le non-recours au RSA avoisine les 40 % chez les agriculteurs, rapporte Magalie Rascle, directrice adjointe déléguée aux politiques sociales de la caisse centrale de la MSA. C’est six points de plus que dans la population générale en 2022, selon la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES). « Traditionnellement, la fierté paysanne a été et demeure un obstacle à la demande des minimums sociaux et tout particulièrement du RSA, assimilé à de l’assistance », souligne François-Xavier Merrien.
Une attitude qui n’est pas sans paradoxe dans un secteur très soutenu par ailleurs. « Sans les aides PAC, il y aurait beaucoup plus d’agriculteurs qui auraient accès au RSA, souligne Marie-Andrée Besson. L’agriculteur vit son métier comme une passion. Il n’imagine pas être dans l’impossibilité d’en vivre. Dans cette optique, le RSA est perçu comme un droit mais pas un revenu, qui ne peut provenir que du travail du paysan. Il apparaît comme une aide aux familles qui permet dégager l’esprit afin de redresser l’exploitation, mais il ne donne pas de quoi remplir le frigo ».
Outre les freins psychologiques, d’autres facteurs entrent en jeu comme un manque de connaissance de ses droits et la complexité et, pour les exploitants, la démultiplication des ressources entrant en jeu dans l’établissement du dossier de demandes de RSA. Sur ce point, François-Xavier Merrien souligne que « la définition du revenu agricole est beaucoup plus complexe que celle du revenu salarial et cette complexité se reflète dans la manière d’accorder ou non une aide sociale ». L’évaluation est compliquée par certaines données : niveau d’endettement, revenus fonciers… « Le revenu fiscal sur lequel on se fonde pour le RSA agricole n’est pas le revenu de la famille, c’est-à-dire une fois les dettes, les emprunts défalqués », alerte d’ailleurs Marie-Andrée.
Le chantier de l‘automatisation
Des travaux sont en cours pour garantir la présence à l’avenir de tous les revenus des exploitants – en particulier les revenus d’activité et certains revenus de remplacement – dans les déclarations trimestrielles de ressources. « N’oublions cependant pas que ceux sont les départements qui décident quels revenus entrent dans le calcul, ce qui entraîne des disparités et aussi un sujet d’équité, prévient la directrice déléguée des politiques sociales de la MSA. Un besoin d’harmonisation est nécessaire afin de trouver un véritable socle commun à tous les non-salariés agricoles. »
Côté MSA, des simplifications ont déjà été engagées récemment ; depuis le 1er février, l’indication du montant net social (MNS), issu automatiquement des données de l’employeur et des organismes de revenus de remplacement sur les déclarations trimestrielles de ressources, est en place. Ce dispositif devrait permettre de réduire la charge déclarative et fiabiliser le calcul des droits. Il devrait offrir une définition plus précise, et normalisée des revenus et le MNS disponible sur les bulletins de paie et relevés de prestations sociales depuis janvier 2024. Il vient remplacer le montant net perçu.
Un autre pas sera franchi durant le 1er trimestre 2025, qui concerne la déclaration des RSA, ajoute Magalie Rascle : « Le montant des aides sociales sera directement récupéré par les Caisses, au travers du DRM (dispositif de ressources mensuelles), rendant inutile la déclaration à remplir (à quelques exceptions près comme les pensions alimentaires d’une part, et les revenus des NSA d’autre part). Celle-ci sera préremplie, laissant néanmoins une possibilité de modification, un peu sur le modèle des impôts à la source. » Des expérimentations sont en cours sur des pré-remplissages des déclarations avec les CAF en Alpes Maritimes, Aube, Hérault, Pyrénées Atlantiques et Vendée.
Quelles que soient les améliorations, le RSA agricole n’en demeure pas moins un enjeu important pour les départements, surtout dans les zones rurales, qui réfléchissent à des évolutions. « Le coût de ce dispositif peut peser lourdement dans les départements à forte proportion d’agriculteurs, explique-t-il chez Départements de France. Ils doivent en effet gérer, en tant que co-financeurs du RSA, des budgets souvent serrés ». Pour l’association, il s’agit de trouver « un équilibre entre la nécessité de soutenir les agriculteurs et celle de responsabiliser les bénéficiaires dans leur démarche d’insertion ou de maintien de leur activité ». Dans un contexte de manifestations agricoles, et de débats budgétaires, l’affaire pourrait être épineuse.
25 000 foyers agricoles bénéficiaires à août 2024
Le RSA comme tremplin pour le début d’activité
Un taux de 40 % de non-recours dans l’agriculture
Quand le RSA soutient le travail saisonnier
Depuis une dizaine d’années, le RSA s’est aussi invité chez les travailleurs saisonniers. « De nombreux départements, ont mis en place des dispositifs permettant de cumuler le RSA avec les revenus tirés d’activités agricoles saisonnières, comme les vendanges, les récoltes maraîchères, celle du houblon, ou la cueillette de fruits », confirme l’association Départements de France. L’objectif est d’attirer de nouveaux publics vers les métiers agricoles, et de développer au passage leurs compétences et leur employabilité. Le Rhône et la Marne ont été les premiers à tester ce dispositif. Depuis, le dispositif s’est élargi à une quinzaine de départements dont la Gironde qui l’adopté en 2019 ou l’Aude en 2020. « Cette expérience peut améliorer les chances de trouver un emploi stable dans le secteur agricole ou dans d’autres secteurs à l’avenir » veut croire Départements de France. Preuve d’un vrai engouement, en septembre dernier, une proposition de loi déposée par la députée de l’Aube, Valérie Bazin-Malgras (LR) visait à conditionner le versement du RSA à l’aide active aux vendanges et aux récoltes agricoles saisonnières.
